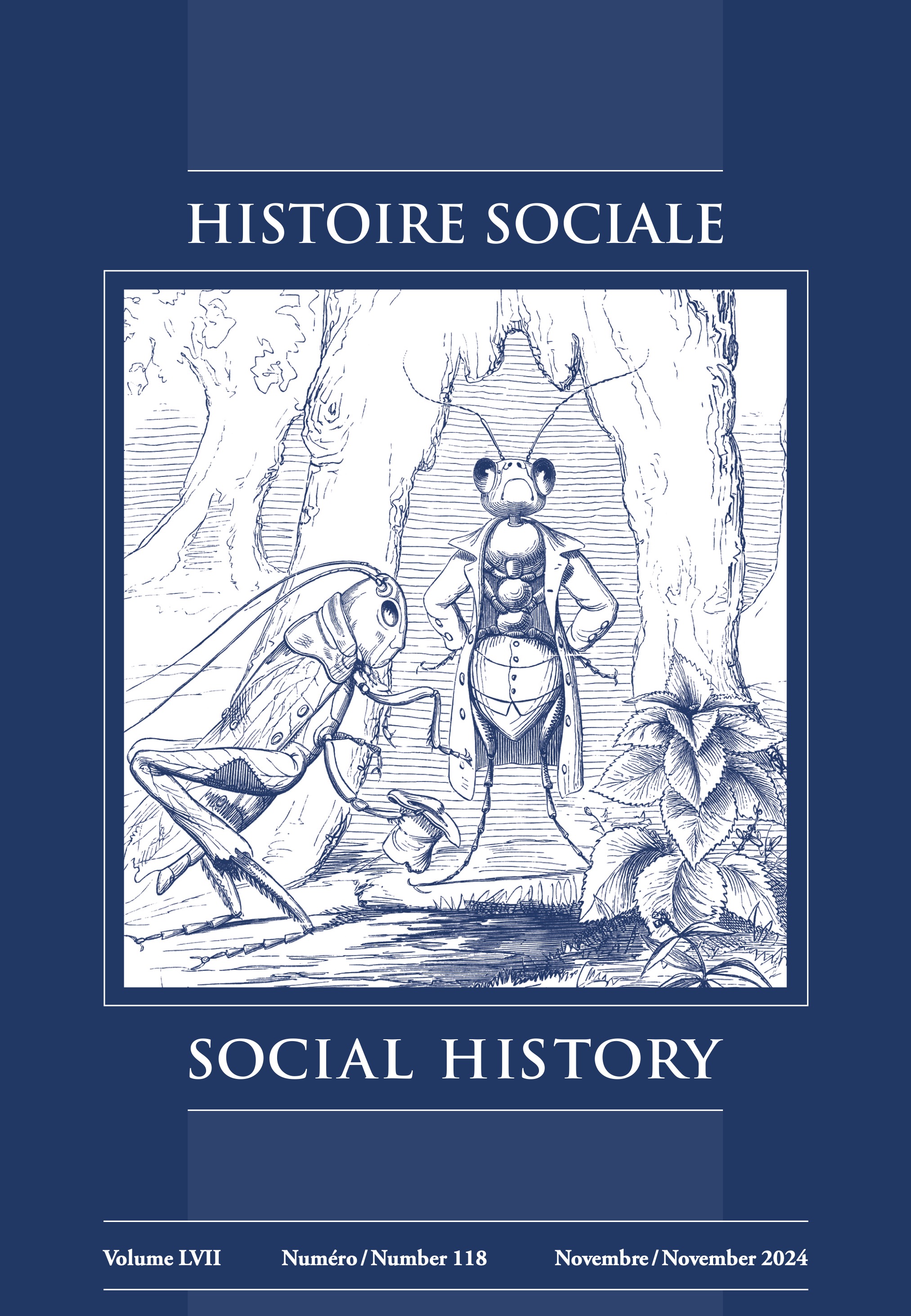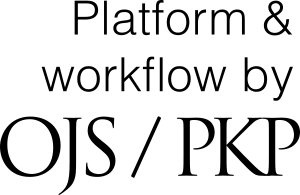De gré ou de force : l’entrée des travailleurs québécois dans la société de consommation
Résumé
Quelle part les gens ordinaires ont-ils prise dans les transformations qui marquent l’entrée dans la société de consommation? Nous étudions ce phénomène par le biais de l’histoire du crédit, en adoptant une perspective « bottom up » qui met aussi en lumière l’agentivité des acteurs sociaux. Notre analyse combine une approche matérialiste de la consommation des travailleurs urbains entre les années 1940 et 1970 et l’étude des politiques, discours et débats internes des organisations syndicales et du mouvement coopératif auxquels, à cette époque, ils adhèrent en grand nombre. Notre principal terrain d’enquête est Montréal, grande ville industrielle et métropole nord-américaine. L’historiographie canadienne a jusqu’ici insisté sur la lenteur des changements des comportements de consommation après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur la prudence des Canadiens à cet égard. Nos sources les présentent sous un autre jour. Après la guerre, les travailleurs et les ménages des classes populaires que nous étudions intègrent rapidement à la gestion de leur budget les nouvelles formes de crédit qui leur sont accessibles. Ils ne se contentent cependant pas de répondre à l’offre de nouvelles institutions, mais créent eux-mêmes des coopératives de crédit ou, à titre de membres, insistent pour que les coopératives Desjardins, dont le réseau est en plein essor, modifient leurs politiques de prêt. Ce sont enfin, selon nous, les pressions qu’ils exercent, en même temps que le constat des nouvelles réalités de leur consommation, qui incitent leurs syndicats à défendre non seulement la légitimité de leurs aspirations à un meilleur niveau de vie, mais celle de leur accès au crédit.